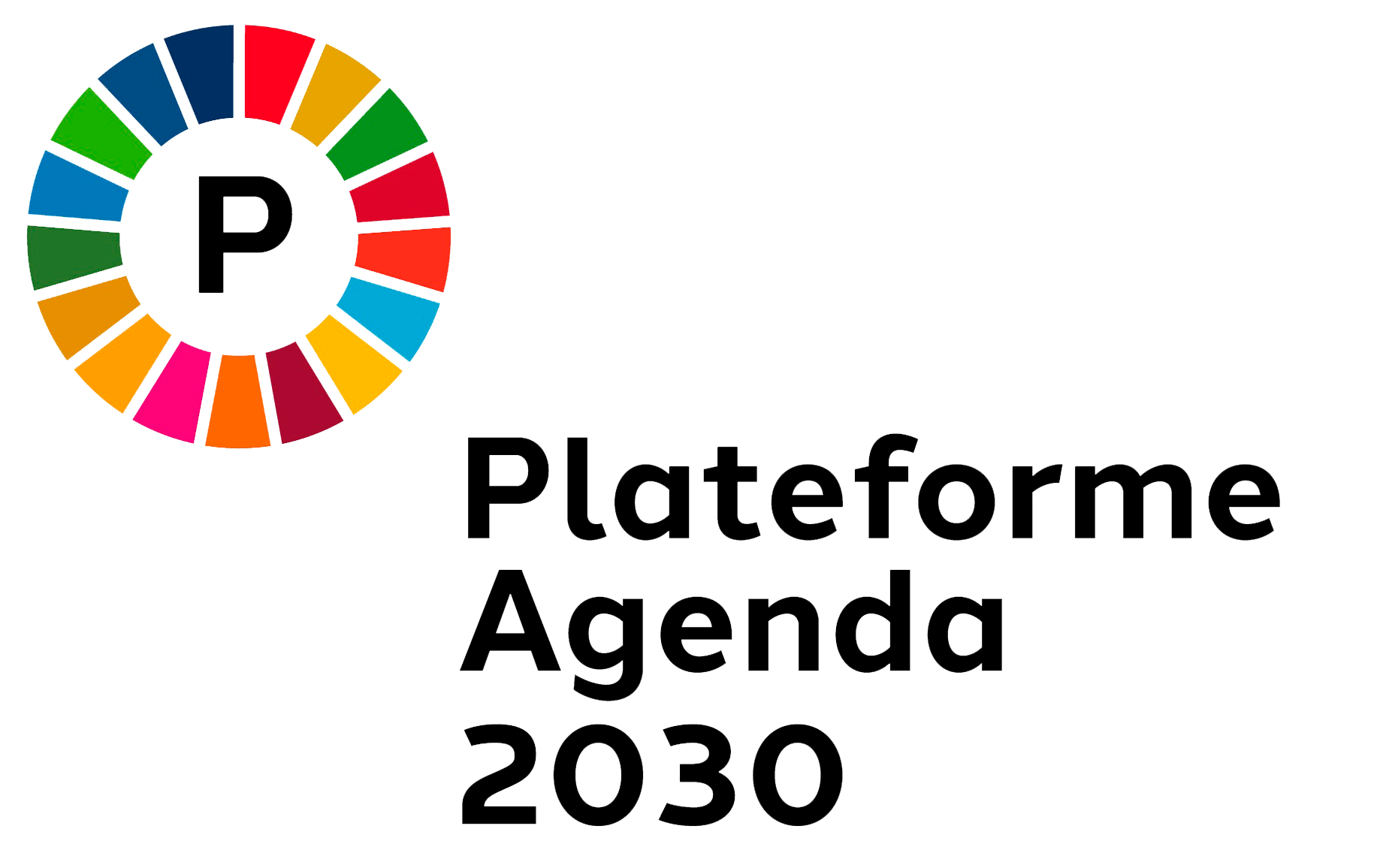Un accord mondial contre la pollution plastique – entre ambitions et blocages
Cet été, à Genève, les négociations internationales pour un accord mondial sur le plastique n’ont pas abouti. Entre les États ambitieux, qui réclament des objectifs clairs de réduction, et les États plus réticents, notamment les pays producteurs de pétrole et de gaz, aucun rapprochement n’est en vue. Le risque que le traité échoue ou se résume à un texte faible et inefficace grandit de jour en jour.
Le plastique est partout : emballages, objets du quotidien, cosmétiques, textiles, électronique – et même, de plus en plus, dans la nature. On retrouve des microplastiques dans les régions les plus reculées, des fonds des océans jusqu’à dans nos veines. Conscients de l’ampleur du problème, les États membres de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA) ont décidé en mars 2022 de négocier, d’ici 2024, un accord juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Ce « traité sur les plastiques » doit couvrir l’ensemble du cycle de vie du matériau : de la production jusqu’à la gestion des déchets en passant par la consommation.
Des attentes élevées, mais des négociations bloquées
Le chemin vers un tel accord s’avère semé d’embûches. Les derniers cycles de négociations en Corée (INC-5) et à Genève (INC-5.2) ont révélé l’ampleur des divergences. D’un côté, une coalition de plus de 100 États exige des objectifs contraignants de réduction de la production et de la consommation. De l’autre, les pays producteurs de pétrole et de gaz – en tête les États du Golfe, mais aussi les États-Unis – rejettent toute régulation ambitieuse. Pour eux, la production de plastique reste un pilier économique. Ils réclament donc des compensations financières ou des règles minimales.
La procédure décisionnelle elle-même est disputée : la Suisse et 85 autres pays défendent le vote à la majorité pour éviter les blocages, tandis que le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine insistent sur le consensus – ce qui, dans les faits, signifie que l’accord risque d’être réduit au plus petit dénominateur commun et de devenir ainsi pratiquement inefficace.
Les revendications de la société civile
Pour les ONG – comme Friends of the Earth (FoEI) – une chose est claire : seul un accord ambitieux et contraignant aura un impact réel. Elles exigent des objectifs mondiaux de réduction, la fin des subventions à la pétrochimie ainsi que l’élimination progressive des polymères et produits plastiques les plus nocifs.
Le recyclage ne suffit pas, il faut une véritable « révolution de la réutilisation » : réparation, systèmes de consigne, alternatives de distribution. En outre, l’exportation de déchets plastiques du Nord vers le Sud doit cesser pour mettre fin au « colonialisme des déchets ».
Les multinationales sont également pointées du doigt. Coca-Cola, Nestlé ou Unilever figurent parmi les principaux pollueurs, sans être véritablement tenus responsables. FoEI demande donc que les entreprises soient soumises à des obligations directes, similaires à celles prévues par le cadre de l’OMS dans la lutte contre l’industrie du tabac. Enfin, le traité doit intégrer une approche fondée sur les droits humains : les communautés autochtones, les travailleuses et travailleurs du secteur de ramassage de déchets et autres groupes vulnérables ne doivent pas porter seuls le fardeau de la transition, mais être soutenus et indemnisés.
Un traité efficace contribuerait aussi directement à l’Agenda 2030, en lien avec les objectifs de consommation et production durables (ODD 12), de protection du climat (ODD 13), des océans (ODD 14) et des écosystèmes terrestres (ODD 15)
Et maintenant ?
Après l’échec de Genève, la communauté internationale est à la croisée des chemins. Trois scénarios sont possibles :
- Le statu quo : poursuivre les négociations, au risque d’aboutir à un texte peu contraignant.
- Une coalition des volontaires : un groupe d’États ambitieux avance seul et ouvre la voie à un traité auquel d’autres pourraient adhérer plus tard.
- Capitaliser sur l’existant : par exemple à travers un protocole dans le cadre de la Convention de Bâle, qui traite déjà en partie du problème du plastique. Mais là aussi, il y a beaucoup de résistance.
La suite reste incertaine. Une chose, en revanche, est sûre : un accord faible serait pire que l’absence d’accord, car il donnerait une illusion de progrès sans changement réel. L’accord sur les plastiques est donc directement lié à l’Agenda 2030 : sans une réduction drastique de la production et de la pollution par les plastiques, plusieurs objectifs de développement durable – du climat à la biodiversité en passant par la santé – ne pourront être atteints.
—
Photo: © Bo Eide

Friedrich Wulf
Pro Natura

Rianne Roshier
Plateforme Agenda 2030