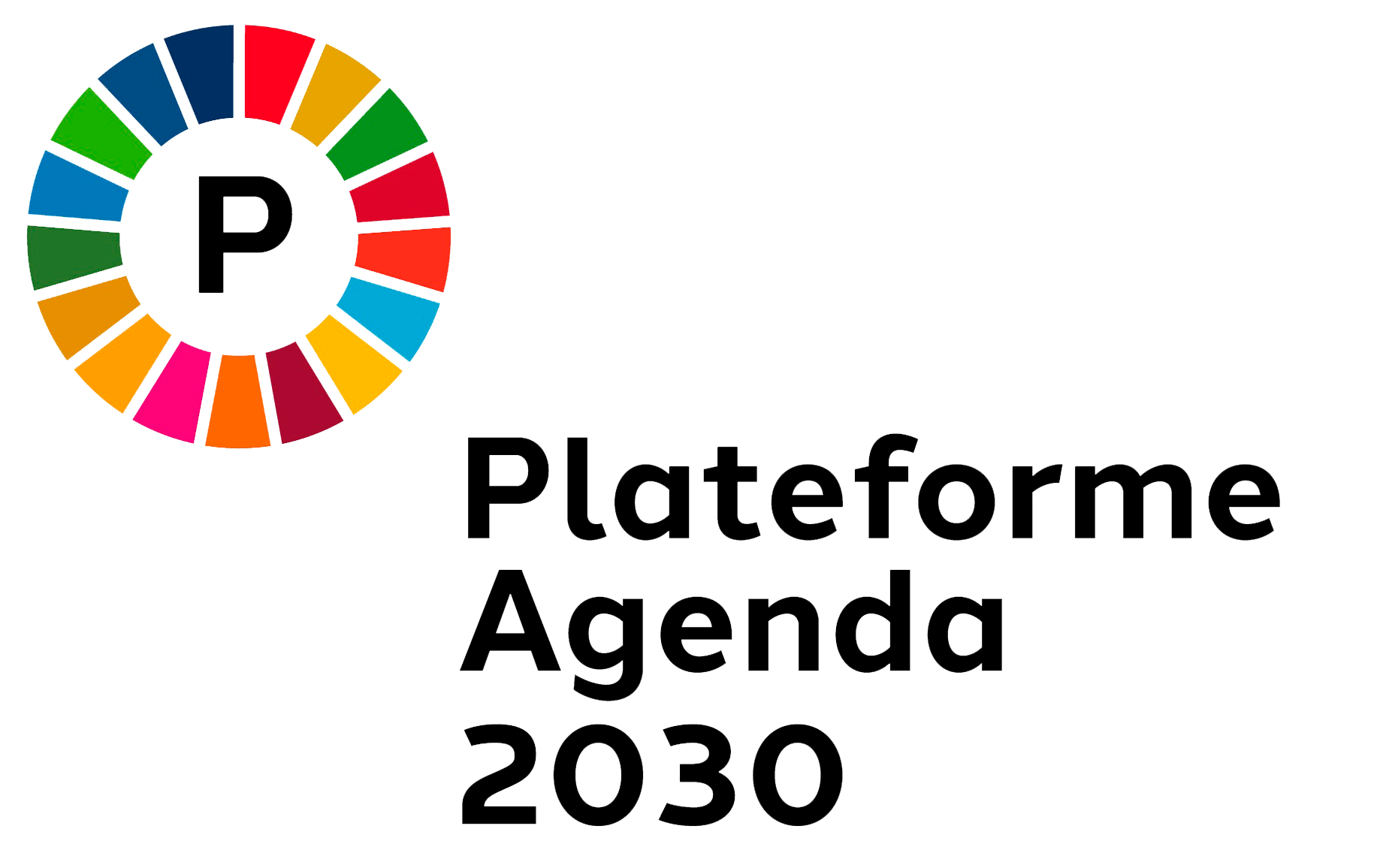30 ans après : Deuxième Sommet mondial pour le développement social de l’ONU
Il y a trente ans, le premier Sommet mondial pour le développement social de l’ONU a bouleversé le monde: il a servi de base aux Objectifs du Millénaire et, de fait, à l’Agenda 2030 pour le développement durable. Malgré un contexte difficile et des tensions géopolitiques, le deuxième sommet, qui se tiendra en novembre à Doha, a le potentiel de rassembler les gouvernements, les scientifiques et la société civile afin de renforcer et de faire progresser les acquis sociaux.
Peu après l’effondrement de l’Union soviétique et la prétendue «fin de l’histoire», selon laquelle la démocratie et l’économie de marché, avec leurs principes libéraux, allaient s’imposer définitivement partout, le premier Sommet mondial pour le développement social des Nations Unies s’est tenu à Copenhague en 1995. Il était considéré comme la «réponse sociale-démocrate» à la politique néolibérale de l’ère Reagan/Thatcher et au consensus de Washington, promu par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). À l’époque, de nombreux pays en développement étaient confrontés aux conséquences désastreuses des mesures d’ajustement structurel néolibérales: à la veille de la conférence, l’ONU a montré dans son rapport States of Disarray comment la déréglementation politique et la libéralisation économique avaient contribué au chômage et aux inégalités.
Des Objectifs du Millénaire…
Trois objectifs étaient au cœur du premier «Sommet social mondial»: la lutte contre la pauvreté, l’emploi productif et l’intégration sociale. Les gouvernements s’étaient alors engagés à respecter un plan en dix points, le Programme d’action de Copenhague. Celui-ci comprenait notamment la protection des droits humains, le renforcement de la coopération et de la solidarité internationales, la non-discrimination et le respect de la diversité, l’égalité des chances et la participation de toutes et tous. Pour mettre en œuvre ce plan, les gouvernements devaient mobiliser les ressources financières nécessaires. Pour y parvenir, l’idée d’une taxe sur les transactions financières (taxe Tobin) ou la demande d’une réduction progressive des dépenses militaires (dividende de la paix) ont été mises sur la table, mais aucune des deux n’a finalement été retenue.
Alors que «l’approche sociale» du Sommet mondial pour le développement social gagnait en influence, les concepts néolibéraux continuaient d’influencer le discours international sur le développement. Afin de concilier ces différentes approches, la Banque mondiale et le FMI ont défini, en collaboration avec l’OCDE et l’ONU, une série d’objectifs centraux en matière de politique de développement. Ce compromis a abouti en 2000 aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD): huit objectifs dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’éducation et de la santé, qui devaient être mis en œuvre dans les pays du Sud. Alors que les OMD ont marqué la politique de développement dans les années 2000, l’approche holistique du Programme d’action de Copenhague est longtemps tombée aux oubliettes.
… vers l’Agenda 2030 révolutionnaire
Cela a changé en 2015, lorsque la communauté internationale a adopté l’Agenda 2030, un programme complet comprenant dix-sept objectifs pour un développement social, économique et écologique durable. Cet agenda révolutionnaire ne s’adresse plus uniquement au Sud global, mais vise à promouvoir la transformation nécessaire vers un ordre économique et social durable et équitable dans tous les pays. Avec cette ambition, l’Agenda représente un changement de paradigme qui a fait de tous les États, y compris la Suisse, de véritables «pays en développement».
Dix ans plus tard, il est évident que les progrès sont insuffisants. Selon la Banque mondiale, malgré des améliorations, 808 millions de personnes vivent toujours dans l’extrême pauvreté, avec moins de 3 dollars par jour. Si l’on considère le seuil de pauvreté de 8,30 dollars pour les pays à revenu intermédiaire, 3,73 milliards de personnes sont privées d’un niveau de vie décent. Alors que le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde a augmenté de 152 millions depuis 2019 pour atteindre 733 millions, Forbes recense désormais 3028 milliardaires (contre seulement 140 en 1987) avec une fortune totale de 16’100 milliards de dollars, soit près de 2000 milliards de plus qu’un an auparavant.
La gueule de bois après la fête
Près de 60% de la main-d’œuvre mondiale occupe des emplois informels. Dans les pays à faible revenu, ce taux atteint même 88,5%. Cela signifie que 3,8 milliards de personnes vivent sans couverture sociale. Alors que les pays riches se rapprochent d’une couverture universelle pour leur population (85,9%), la proportion de personnes ayant accès à des systèmes de sécurité sociale dans les pays pauvres n’a guère augmenté depuis 2015, avec moins de 10%. Les gouvernements n’ont tout simplement pas les moyens financiers nécessaires. Compte tenu de l’endettement mondial et de l’incertitude économique, de plus en plus de gouvernements misent sur des mesures d’austérité, les coupes dans l’aide publique au développement (APD) aggravant encore la situation dans les pays pauvres.
En réaction aux bouleversements sociaux et à la politique d’austérité oppressante, les ONG, les syndicats, les scientifiques et les institutions des Nations unies exigent que la politique soit davantage axée sur les objectifs de développement social. Leurs attentes font actuellement l’objet de débats à Doha. Parmi celles-ci figure la campagne pour mettre fin à l’austérité (End Austerity Campaign), qui réclame une imposition plus élevée des riches et des grandes entreprises, l’introduction d’une taxe sur le numérique et les bénéfices exceptionnels, l’annulation de la dette des pays les plus pauvres, une meilleure lutte contre la fraude fiscale et des investissements publics dans le domaine social. Elle comprend également la création d’un Fonds mondial pour la protection sociale visant à aider les pays pauvres à mettre en place, développer et financer des systèmes sociaux.
En 2021, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a lancé l’Initiative pour l’emploi et la protection sociale en faveur d’une transition juste (Just Transition). Elle vise à créer au moins 400 millions de nouveaux emplois dans l’économie verte et les services sanitaires d’ici 2030 et à étendre la protection sociale de base aux près de quatre milliards de personnes qui en sont actuellement exclues. Les syndicats, quant à eux, réclament un nouveau contrat social (New Social Contract) pour faire respecter les droits des travailleuses et des travailleurs dans le monde entier. L’Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD) a repris cette idée et l’a élargie à la dimension écologique.
Une occasion unique
En amont du sommet, des négociations intergouvernementales prometteuses ont eu lieu en vue d’une déclaration politique concise et orientée vers l’action (Political Declaration). Celle-ci s’appuie notamment sur le Rapport social mondial 2025 de l’ONU. Elle réclame une répartition plus équitable du pouvoir et de la prospérité ainsi qu’une coopération internationale renforcée.
Le projet zéro rédigé par la Belgique et le Maroc, qui dirigent le processus, a été largement approuvé par de nombreux gouvernements. Les pays en développement le qualifient de «bonne base pour les négociations», mais soulignent en même temps que les inégalités structurelles et le droit au développement doivent être davantage pris en compte. Pour eux, l’importance de l’aide publique au développement, l’accès équitable aux produits médicaux et la suppression des barrières douanières et des obstacles non tarifaires au commerce sont tout aussi essentiels que la lutte contre les flux financiers illicites.
Trois décennies après le premier sommet, qui a ouvert la voie aux Objectifs du Millénaire pour le développement, puis aux Objectifs de développement durable, le monde est confronté à de nouveaux défis dans un contexte géopolitique tendu. Le deuxième Sommet mondial pour le développement social offre précisément une occasion unique de s’attaquer aux graves injustices sociales et de remettre la justice sociale à l’ordre du jour de la politique internationale.
Photo: © Ferdinand Feys

Patrik Berlinger
Chargé de communication politique, Helvetas