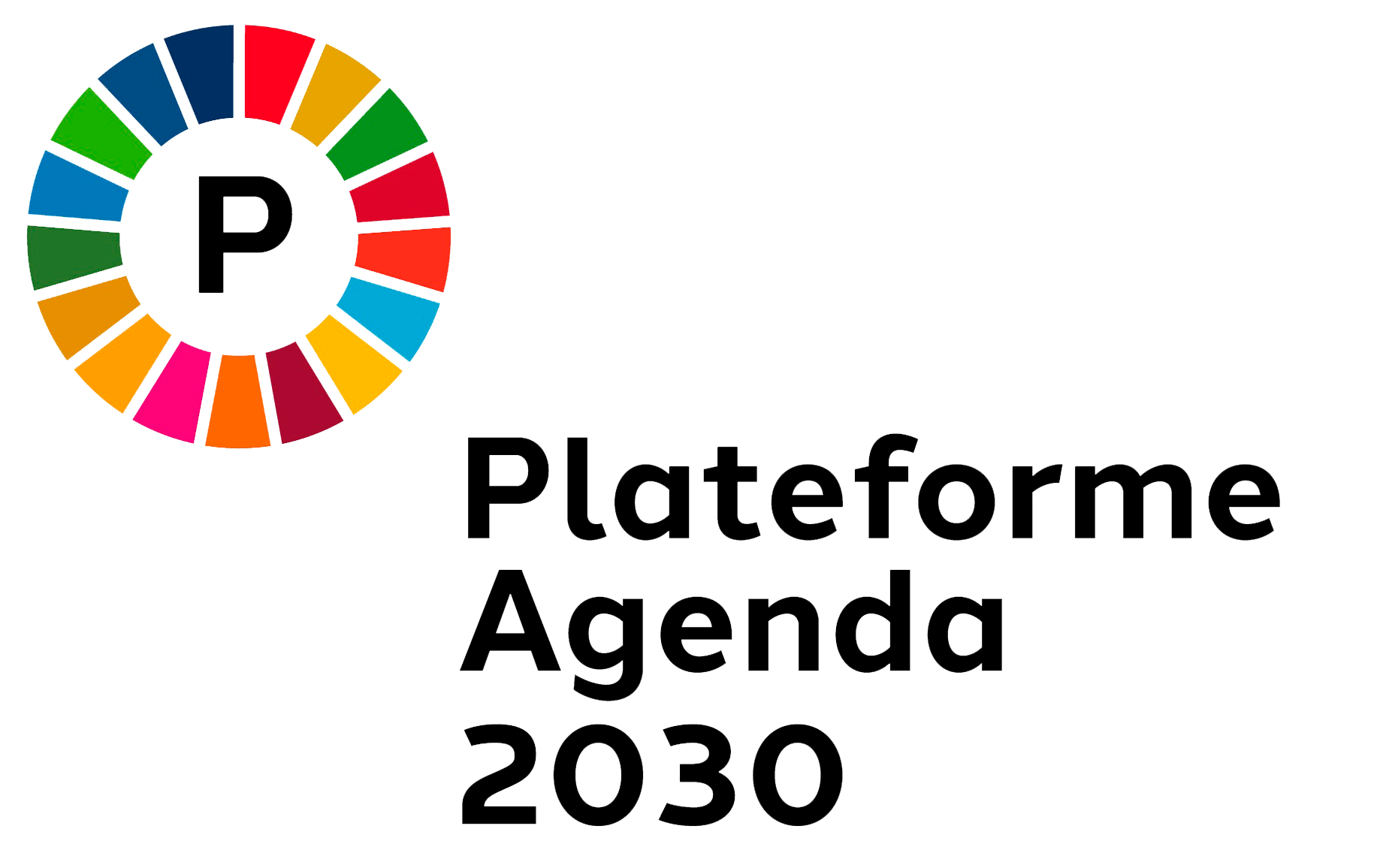Nouveau rapport de l’ONU : progrès insuffisants en matière d’égalité
Trente ans après l’adoption de la Plateforme d’action de Beijing, le nouveau rapport de l’ONU « Gender Snapshot 2025 » dresse un bilan décevant : le monde est encore loin d’une véritable égalité des genres. Certes, des progrès ont été réalisés, mais ils sont trop lents, trop fragiles et il existe encore de grandes disparités régionales. Dans le cadre de l’Agenda 2030 également, la mise en œuvre de l’ODD 5 (égalité des sexes) reste décisif pour le développement durable dans son ensemble.
En 1995, les pays ont adopté le Programme d’action de Beijing qui est, encore aujourd’hui, considéré comme la feuille de route mondiale la plus complète en matière de droits des femmes. Le programme identifie douze domaines d’action critiques dans lesquels les États du monde devraient réaliser l’égalité – et il reste des progrès à faire. L’Agenda 2030 s’appuie sur ces fondements : sans égalité (ODD 5) et sans élimination de la pauvreté (ODD 1), il est difficile de progresser vers les autres objectifs de développement durable des Nations unies.
La pauvreté a un visage féminin
Environ 9,2% des femmes et des filles vivent dans l’extrême pauvreté. Les femmes d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud et centrale sont particulièrement touchées. Dans le monde entier, les femmes effectuent deux fois et demie plus de tâches domestiques et de soins non rémunérés que les hommes, ce qui constitue un obstacle majeur à la réalisation de l’ODD 8 (travail décent et croissance économique). La vulnérabilité particulière des femmes se manifeste également à la retraite, lorsque leurs rentes sont souvent insuffisantes pour mener une vie autonome et digne – un problème structurel qui reflète des décennies d’inégalité en matière de revenus et de soins. Afin de développer des mesures efficaces, il est indispensable de collecter des données de manière systématique et différenciée selon le sexe.
Faim, santé et insécurité
Les conséquences des carences alimentaires sont particulièrement graves chez les femmes et les filles. L’anémie, souvent due à une alimentation insuffisante, augmente par exemple le risque de naissances prématurées et d’insuffisance pondérale à la naissance. Elle entrave la croissance et l’apprentissage des enfants, en particulier dans les ménages les plus pauvres, et menace la capacité de travail. En Asie du Sud, l’anémie entraîne une perte annuelle estimée à 32,5 milliards de dollars, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté et de la mauvaise santé.
En raison du sous-financement persistant des programmes de santé et de nutrition, le taux d’anémie dans le monde risque de passer de 31,1% (2025) à 33% (2030), ce qui est loin de l’objectif de le réduire de moitié d’ici 2030. Les objectifs centraux des ODD 2 (faim « zéro ») et 3 (bonne santé et bien-être) ne seront donc pas atteints.
Des progrès limités
Si les filles dépassent les garçons dans le monde entier en matière de scolarisation, elles restent toutefois à la traîne en termes de diplômes, notamment en Afrique et en Asie. Et l’égalité dans les postes à responsabilité reste un objectif lointain : selon le rapport, seuls 27,2% des sièges dans les parlements nationaux sont occupés par des femmes, et leur proportion dans les instances dirigeantes est de 30%.
Au rythme actuel, il faudra près de 100 ans pour que les femmes occupent des postes de direction à égalité dans l’économie, ce qui constitue un revers pour la réalisation des ODD 4 (éducation de qualité) et 10 (inégalités réduites).
Opportunités numériques – et nouvelles inégalités
Dans un monde de plus en plus numérique, des différences entre les sexes persistent dans l’utilisation d’Internet : environ 65% des femmes et 70% des hommes dans le monde utilisent Internet, mais ces moyennes mondiales masquent des différences régionales considérables qui désavantagent nettement les femmes dans de nombreux pays.
L’inclusion numérique pourrait pourtant changer la donne : si les femmes du monde entier avaient un accès égal à la technologie et à l’éducation, plus de 340 millions d’entre elles pourraient en bénéficier.
Violence, guerre et crise climatique : vieilles blessures, nouvelles menaces
Chaque année, une femme sur huit subit des violences physiques ou sexuelles de la part de son (ex-)partenaire. Les femmes sont particulièrement vulnérables dans les conflits et les guerres : elles représentent plus de la moitié des personnes déplacées dans le monde. Et la crise climatique menace de plonger plus de 150 millions de femmes supplémentaires dans la pauvreté.
Le viol est toujours utilisé comme arme de guerre – son interdiction reste théorique dans de nombreux endroits. Depuis plus de vingt ans, la résolution 1325 « Femmes, paix et sécurité » de l’ONU appelle à impliquer et à protéger les femmes dans les processus de paix. Mais à ce jour, des milliards sont investis dans les armes, tandis que l’éducation et les soins restent sous-financés. Cela montre l’urgence d’une action cohérente dans l’esprit de l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces).
Ce qui compte maintenant
Dans le cadre du Programme d’action Beijing+30, le rapport appelle à six priorités mondiales :
- Participation numérique des femmes et des filles
- Lutte contre la pauvreté
- Zéro violence
- Égalité des droits en matière de décision et de direction
- Paix, sécurité et justice climatique
- Renforcement des organisations de femmes dans le monde entier
Conclusion
Trois décennies après Beijing, l’égalité reste une promesse non tenue. Le progrès n’est possible que si les engagements politiques sont soutenus par des actions concrètes et des investissements suffisants, tant publics que privés. Partout dans le monde, les femmes sont les premières victimes des crises, qu’il s’agisse de la pauvreté, de la violence ou de la catastrophe climatique. Mais elles sont aussi les moteurs du changement.
Le Programme d’action Beijing+30 montre comment une participation équitable, la sécurité et des chances pour toutes et tous peuvent devenir réalité, conformément à l’Agenda 2030, qui vise à ne laisser personne de côté (leave no one behind). Les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent désormais agir ensemble.

Laura Pascolin
Coordination post Beijing des ONG Suisses