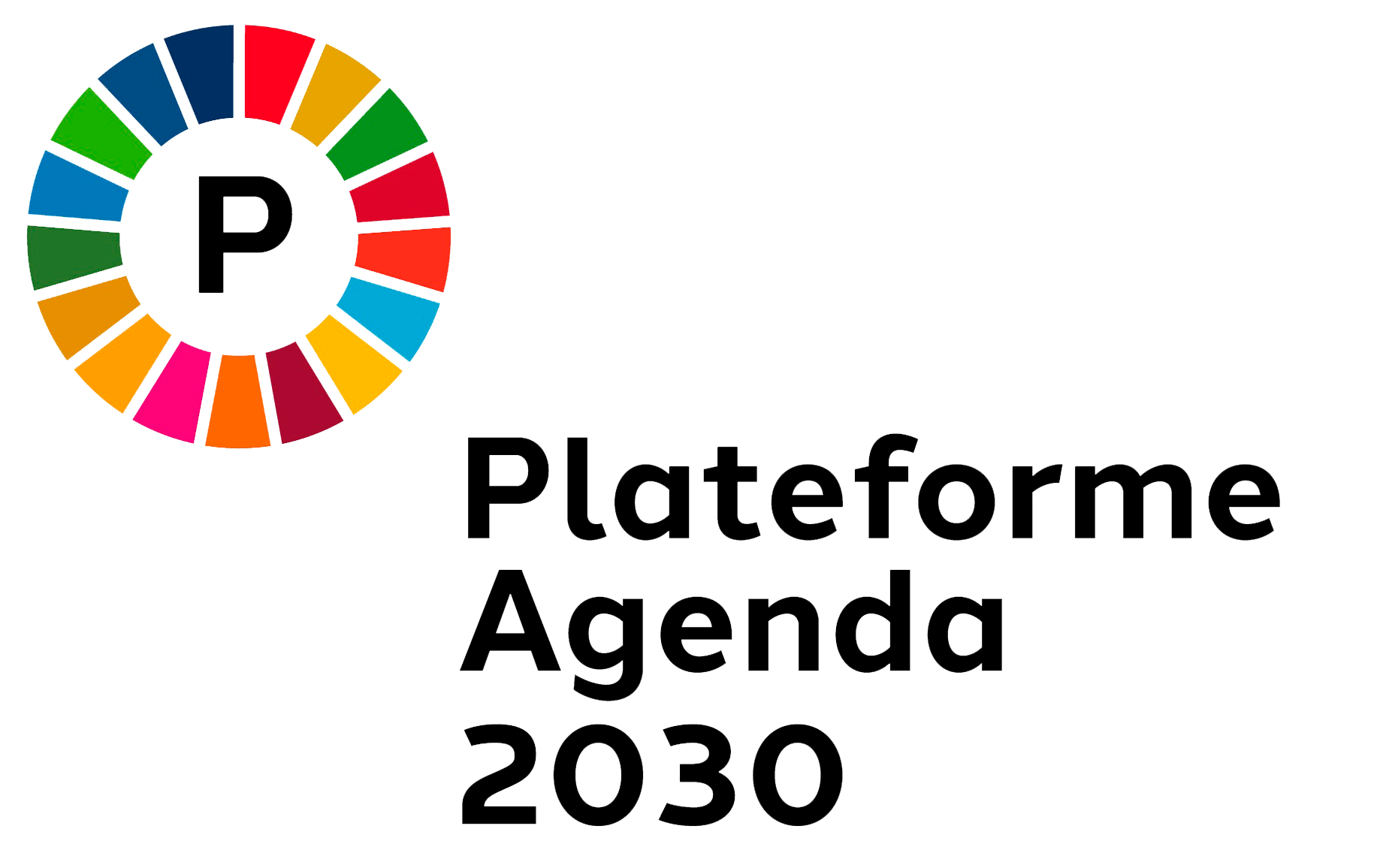Conférence FfD4 à Séville : un pas vers un monde plus juste ?
La 4ème Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement (FfD4) s’est tenue à Séville du 30 juin au 3 juillet. Avant la conférence, les États s’étaient déjà mis d’accord sur une déclaration finale toutefois insuffisante. Des réponses aux innombrables crises n’étaient pas apportées et les décisions prises à Séville sont restées bien en deçà des revendications de la société civile et des pays du Sud. Alliance Sud y était pour un aperçu des points les plus importants – voir l’article complet ici.
Une conférence marquée par des promesses non tenues
La FfD4 s’ouvrait sur fond de déclaration finale déjà négociée (l’Engagement de Séville (Compromiso de Sevilla)), déjà jugée très insuffisante par les acteurs de la société civile. Les revendications des pays du Sud global, notamment en matière de politique financière et de dette internationale, n’ont pas été prises en compte. Malgré l’urgence — 68 pays en développement souffrent d’un endettement aigu —, aucune réforme structurelle n’a été décidée.
La crise de la dette : des paroles fortes, peu d’actes
Des chiffres accablants illustrent la situation : au Liban, 88 % des recettes publiques servent au remboursement de la dette ; dans 48 pays du Sud, les intérêts surpassent les dépenses en santé ou éducation. Le système actuel profite aux créanciers, souvent situés dans les pays riches. L’économiste Jayati Ghosh a qualifié la situation de « faillite de la politique de développement ». En rappelant que l’Allemagne avait elle-même bénéficié d’un effacement de dette en 1954, elle a proposé cinq principes pour une réforme équitable de la gestion de la dette:
- des délais limités (3-6 mois) pour les négociations de restructuration entre partenaires égaux ;
- un moratoire pendant les discussions ;
- la fin du renflouement des créanciers privés ;
- l’abandon de l’austérité imposée par le FMI ;
- l’accès maintenu aux marchés pour les pays surendettés.
Malgré le soutien de la société civile et des pays concernés, ces propositions n’ont pas été reprises dans le texte final.
Fiscalité mondiale : la pression monte pour taxer les super-riches
Un panel de haut niveau, comprenant notamment la vice-présidente et ministre des Finances espagnole María Jesús Montero et le prix Nobel Joseph Stiglitz, s’est penché sur la taxation des ultra-riches et des grandes entreprises. Le constat : les systèmes fiscaux actuels favorisent l’injustice, notamment à cause de l’évasion fiscale des multinationales. Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal, a souligné que les fortunes doivent être imposées là où elles sont créées. Les États africains réclament une convention fiscale contraignante des Nations unies afin de garantir l’équité fiscale mondiale.
Mobilisation des ressources domestiques
La mobilisation des ressources nationales (Domestic Resource Mobilization, DRM) vise à aider les pays du Sud à réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide financière étrangère. Mais la fuite des capitaux et l’opacité des flux financiers entravent la mise en place de systèmes fiscaux équitables. Chennai Mukumba, du Tax Justice Network Africa, a mis en garde contre les mécanismes fiscaux régressifs tels que la taxe sur la valeur ajoutée, qui pèsent de manière disproportionnée sur les populations pauvres. Il faut au contraire un système fiscal mondial équitable, dans lequel la Suisse joue également un rôle central.
L’impasse du « de-risking » et de la finance privée
La conférence a été dominée par l’agenda du de-risking, qui vise à sécuriser les investissements privés dans le Sud avec des fonds publics du Nord. L’économiste Daniela Gabor critique cette logique : elle n’a pas permis de transformer les « milliards en milliers de milliards » promis. Pire, elle affaiblit les États du Sud en les rendant dépendants de capitaux privés.
Une alternative : la Banque de la nature
Des États insulaires du Pacifique – dont l’existence est menacée par la crise climatique – ont présenté la Development Bank for Resilient Prosperity (DBRP), ou « Banque de la nature », qui valorise la biodiversité comme actifs économiques. Fondée sur la résilience humaine et environnementale, et non sur la rentabilité des investisseurs, cette démarche valorise les mangroves, forêts ou encore tourisme durable comme source de financement qui renforce la création de valeur locale.
Une société civile mobilisée… mais reléguée
Enfin, la société civile, bien que très active les premiers jours avec des centaines d’événements parallèles, a été largement exclue des discussions officielles. Ce manque d’inclusivité envoie un signal négatif de la part de l’ONU, alors même que l’espace démocratique se réduit dans de nombreux pays.
Conclusion
La FfD4 a été l’occasion pour la société civile et les pays du Sud global de réaffirmer leurs exigences en matière de justice fiscale, d’annulation de la dette et de souveraineté économique. Mais les obstacles restent nombreux, entre la puissance des créanciers, l’échec des mécanismes multilatéraux existants, et la persistance d’un modèle économique néolibéral de développement. La mobilisation continue, notamment autour d’une convention fiscale des Nations Unies, d’une réforme de la gouvernance de la dette, et de solutions alternatives fondées sur la durabilité et l’équité.
Source photo: Alliance Sud